L’ambassadeur de l’Angola au Gabon Joaquim do Espírito Santo, a accordé en exclusivité, une grande interview à la rédaction de Gabonactu.com à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de l’indépendance de son pays. Dans cet entretien, le diplomate retrace la douloureuse histoire de la lutte d’indépendance de son pays contre le colon portugais, la guerre civile qui a éclaté et déchiré la jeune nation dès 1975 et la reconstruction lancée après les accords de 2002. L’Angola un poids lourd du continent. Interview à lire absolument !
Excellence, comment décririez vous le contexte dans lequel a débuté la lutte de libération de l’Angola contre la colonisation portugaise ?
Vous savez, la lutte de libération de l’Angola a débuté dans un contexte de résistance croissante contre le colonialisme portugais, exacerbée par l’influence internationale de l’après-Seconde Guerre mondiale et la répression du régime autoritaire de Salazar. António de Oliveira Salazar était un dictateur qui a dirigé le Portugal de manière autocratique de 1933 à 1968, s’inspirant du nationalisme et du fascisme émergents en Europe. Ce contexte comprenait les activités clandestines de mouvements patriotiques cherchant à sensibiliser l’opinion publique et à dénoncer les atrocités, aboutissant à des actions armées qui ont débuté le 4 février 1961 par des attaques contre les prisons politiques. L’un des événements déclencheurs fut le massacre de Baixa Cassange en janvier 1961, lorsque les troupes portugaises bombardèrent des paysans en grève.
Quels ont été les principaux mouvements et figures emblématiques de cette guerre d’indépendance ?
Les principaux mouvements de la guerre d’indépendance angolaise étaient le MPLA (Mouvement populaire de libération de l’Angola), le FNLA (Front national de libération de l’Angola) et1’UNITA (Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola). Agostinho Neto (MPLA), qui devint le premier président du pays, Jonas Savimbi, chef de l’UNITA, et Holden Roberto (FNLA) furent les figures emblématiques de ces trois mouvements de libération qui, bien que convergeant vers la lutte pour l’indépendance du colonialisme portugais, avaient des bases géographiques et ethniques distinctes.
Quelles ont été, selon vous, les valeurs qui ont porté le peuple angolais dans sa quête de
Liberté ?
Les valeurs qui ont animé le peuple angolais dans sa quête de liberté étaient le désir d’une nation souveraine et juste, l’autodétermination pour bâtir un avenir affranchi de la colonisation, l’unité et le sacrifice collectif pour parvenir à l’indépendance politique. Ces valeurs ont permis aux Angolais de surmonter plus de 400 ans de domination étrangère et de forger un pays porteur du rêve de liberté, d’égalité et de progrès.
Comment l’Angola se souvient-il aujourd’hui de cette période et honore-t-il la mémoire des combattants de la libération ?
Les principales dates qui ont marqué notre histoire figurent sur la liste des événements nationaux, notamment le 4 janvier 1961, avec la grève de Baixa de Cassange ; le 4 févier 1961, considéré comme le début de la lutte armée pour l’indépendance ; le 15 mars 1961, avec les attaques dans le nord de l’Angola ; le 4 avril 2002 qui marque la signature des accords de paix mettant fin au conflit armé ; et le 11 novembre 1975, jour de la proclamation de l’indépendance.
Ainsi, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de notre indépendance, le Président de la République, Joäo Manuel Gonçalves Lourenço, a rendu hommage aux personnalités nationales et étrangères qui ont soutenu la libération et la consolidation de la paix en Angola, réaffirmant la dimension continentale de la solidarité africaine qui a porté la lutte de libération.
Quelle importance revêt, pour les jeunes générations angolaises, la transmission de l’histoire de la lutte pour l’indépendance ?
Comme on dit, l’histoire ne s’efface pas, mais il faut s’en souvenir. Une nation qui se souvient est une nation riche, porteuse d’un avenir prometteur. La jeunesse angolaise étant essentielle l’avenir du pays et le moteur de son développement social, économique et politique, il est impératif qu’el1e comprenne la signification de l’indépendance, acquise après plus de 400 ans de colonisation, et la valeur de la souveraineté nationale dans la construction d’un avenir libre et juste.

Transmettre l’histoire de la lutte de l’Angola pour son indépendance aux nouvelles générations est crucial pour qu’elles comprennent l’identité nationale et les combats qui ont façonné le pays. Cette transmission renforce le sentiment d’appartenance, rend hommage au sacrifice des héros de la nation et offre des leçons du passé pour guider l’avenir du pays, favorisant ainsi1’unité et le progrès.
La guerre civile : les années d’épreuve (1975-2002)
L’indépendance acquise en 1975 a malheureusement été suivie d’une longue guerre civile. Quelles en ont été les principales causes ?
Vous savez, mon pays, l’Angola, est l’un des cas les plus emblématiques de l’Afrique contemporaine, illustrant parfaitement le croisement entre conflit armé prolongé, intervention internationale et défis de la reconstruction.
Le conflit armé angolais a débuté en 1975, peu après la signature des accords d’Alvor, qui ont scellé la fin de la colonisation portugaise et reconnu l’indépendance de l’Angola. Cependant, loin d’inaugurer une ère de stabilité, l’indépendance a ouvert la voie à un conflit violent entre les trois principaux mouvements de libération : le MPLA, l’UNITA et le FNLA. Ces mouvements, bien que combattant sur différents fronts contre le pouvoir colonial portugais, sont rapidement devenus des adversaires dans la lutte pour le contrôle du nouvel État angolais.
Par conséquent, comprendre le conflit armé en Angola exige une approche multidimensionnelle qui prenne en compte à la fois les facteurs internes — rivalités politiques, fragmentation sociale, absence d’institutions fortes — et les éléments externes qui ont alimenté ce conflit, lequel est rapidement devenu l’un des principaux théâtres d’options de la Guerre froide sur le continent africain. Bien que la lutte pour le pouvoir en Angola ait eu des racines internes, la polarisation idéologique mondiale et les intérêts stratégiques des superpuissances ont transformé le conflit en un prolongement indirect de la rivalité entre les États-Unis et l’ancienne Union soviétique, devenue la Russie.
Comment cette guerre a-t-elle affecté le tissue social économique et politique du pays?
La persistance du conflit pendant près de trois décennies a détruit des infrastructures essentielles, paralysé le développement national et, par conséquent, aggravé les difficultés économiques existantes, sapé la cohésion sociale et engendré l’une des crises humanitaires les plus graves du continent africain. Des millions de civils ont été déplacés et les mines anti personnelles laissées par le conflit continuent de menacer les populations rurales. Ainsi, les conséquences de la guerre sont désastreuses. La guerre ne se contente pas de tuer, elle tue aussi l’espoir en provoquant des traumatismes et des syndromes de stress post-traumatique.
Quelle a été la contribution de la communauté internationale et des pays africains, notamment du Gabon, dans les efforts de médiation ?
La communauté internationale, et les pays africains en général, ont joué un rôle crucial dans les efforts de médiation, en dirigeant des missions de médiation, en fournissant un soutien logistique et financier et en exerçant une pression diplomatique.
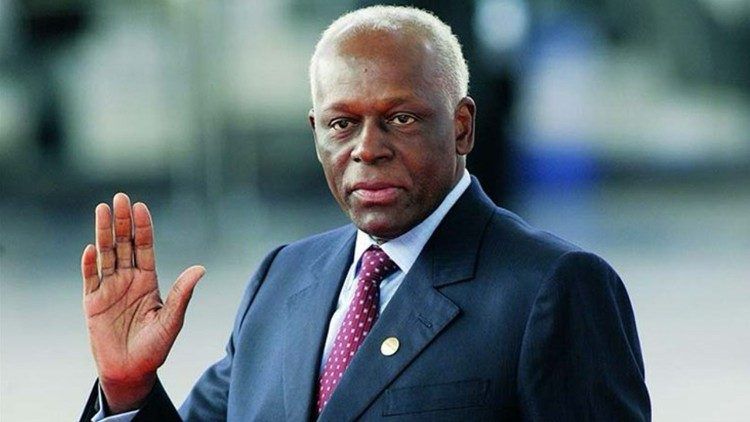
La République gabonaise, sous la direction du Président El Hadj Omar Bongo Ondimba, en tant que membre de l’Union africaine et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), a été l’un des pays africains activement impliqués dans la recherche d’une solution pacifique au conflit angolais. Le Gabon a aussi accueilli, particulièrement à Franceville, des pourparlers de paix et de réconciliation en Angola, visant à mettre fin au conflit armé. Ces négociations ont été cruciales pour le processus de paix en Angola. L’Angola reconnaît et apprécie le soutien inestimable qu’il a reçu des pays frères africains, en particulier du Gabon.
Que retenez-vous du processus de paix signé en 2002, et comment ce tournant a-t-il changé la trajectoire du pays ?
L’accord de paix de 2002 en Angola a marqué la fin de 27 années de conflit armé, qui avaient engendré d’immenses souffrances et de nombreuses pertes humaines. Son principal objectif était l’intégration des forces armées des deux camps, la démobilisation des troupes et la tenue
d’élections. La signature de cet accord a permis la réunification du pays et la reconstruction de la société, avec le soutien d’organisations internationales telles que les Nations Unies.
Ce tournant décisif a changé la trajectoire du pays en permettant la reconstruction nationale, la réunification politique, la réintégration au sein de la communauté internationale et une croissance économique durable dans des secteurs comme celui du pétrole, grâce à l’ouverture du pays aux investissements internationaux.
L’Angola d’après-guerre : paix, développement et diplomatie
Vingt-trois ans après la fin du conflit, comment évaluer-vous le chemin parcouru par l’Angola sur les plans économique, social et politique ?
Sur le plan politique, je suis heureux de souligner que l’Angola est aujourd’hui un pays stable et un acteur incontournable de la prévention et de la résolution des conflits, proposant une doctrine de paix et de réconciliation nationale post-conflit. Ses multiples mandats en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, sa participation à de multiples missions de maintien de la paix et son leadership dans diverses initiatives de médiation, ainsi que l’accueil de la Biennale de Luanda pour la culture de la paix et de la non-violence, dont la reconnaissance a consacré l’Angola, en la personne de Son Excellence Joäo Manuel Goncalves Lourenço, Président de la République, comme Champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, une étape hautement pertinente qui fait la fierté de tout Angolais.
Sur les plans économique et social, les 23 années de paix ont été marquées par des investissements continus dans la réparation,1a reconstructionet la construction d’un large éventai1d’infrastructures et mis en place les écosystèmes nécessaires à une industrialisation avec un contenu local significatif.
Aujourd’hui, l’Angola a évolué sur tous les plans. D’environ 6,5 millions d’habitants en 1975, l’Angola en compte aujourd’hui environ 35 millions. Malgré les multiples défis qui persistent, la situation est bien différente, grâce aux investissements que nous avons réalisés ces dernières années. En matière de logement, l’État a dû intervenir. Un ambitieux Programme national d’urbanisme et de logement a été lancé, permettant la construction, par l’État seul, d’environ 350.000 logements repartis en quartiers centraux, lotissements urbains et logements sociaux. C’est effort de l’Etat se poursuit encore aujourd’hui.
Le corridor de Lobito joue un rôle stratégique incontestable dans la circulation des biens et des matières premières essentiels aux technologies de pointe et à la transition énergétique, à travers l’océan Atlantique, vers les marchés mondiaux. Il est bien plus qu’une voie de transport de matières premières et de produits divers, mais plutôt un pôle de développement essentiel pour l’intégration régionale et la dynamisation de la Zone de libre-échange continentale africaine, où seront implantés d’importantes industries, des projets agro-industriels de grande envergure et une variété de services.
Nous avons beaucoup investi dans la production d’électricité pour soutenir notre grande ambition de développement par 1”industrialisation du pays. Au moment de la proclamation de l’indépendance, le système hérité du régime colonial avait une capacite de production énergétique de 450 Mégawats, qui avait été substantiellement réduite à environ 250 Mégawatts en 1989, en raison de la destruction des infrastructures causée par la guerre. Aujourd’hui nous avons porté la capacité de production d’électricité du pays à 6.272 MW, avec pour objectif de porter la capacité totale ä 9.000 MW d’ici 2027.
Quelles sont aujourd’hui les grandes priorités du gouvernement angolais en matière de développement durable et diversification économique ?
Les principales priorités de gouvernement angolais sont aujourd’hui de favoriser la production et l’exportation de biens non pétroliers, en misant sur le secteur manufacturier à fort potentiel de substitution aux importations ; d’améliorer les infrastructures (routes, énergie, eau et assainissement) ; et de s’aligner sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, notamment en matière de santé, d’emploi, de lutte contre le changement climatique, d’égalité des sexes et de réduction de la pauvreté.
Le gouvernement angolais privilégie également la croissance de secteurs tels que l’agriculture, la pêche, la construction et la finance, considérant la stabilité macroéconomique comme un pilier fondamental. Il vise ainsi l’équilibre budgétaire, la stabilité du pouvoir d’achat et la stabilité monétaire et du taux de change.
Par conséquent, le gouvernement angolais s’engage à transformer les ressources naturelles du pays en une véritable richesse pour le bien-être de sa population.
Quelle est la nature des relations actuelles entre l’Angola ct le Gabon ?
Avant tout, je tiens à souligner que les relations entre l’Angola et le Gabon sont aux beaux fixes. Il s’agit de relations de coopération bilatérale et d’amitié qui s’inscrivent dans la volonté partagée par les deux pays, dont les territoires respectifs appartenaient au même royaume, le Royaume du Congo, vers le XlII siècle. Les deux pays œuvrant au renforcement de leurs liens historiques et à la promotion d’un partenariat axé sur les questions de coopération Economiques et culturelles fondées sur la confiance mutuelle et les intérêts communs.

Pourtant, nous nous félicitons de notre engagement commun en faveur du renforcement continu des excellentes relations de fraternité, d’amitié et de coopération qu’entretiennent nos deux pays, l’Angola et le Gabon, aussi bien sur le plan bilatéral que sur la scène africaine et internationale. Nous aspirons à une relation de coopération qui représente un modèle de relation stable.
Quel message souhaitez-vous adresser à la diaspora angolaise vivant au Gabon à l’occasion de ce jubilé d’or de l’indépendance ?
A tous mes compatriotes, je souhaite avant tout la santé, la paix et le bonheur. Les acquis de l’indépendance nationale et de la paix sont des jalons indélébiles de notre histoire, emplissant chacun de nous de fierté et nous encourageant à affronter le long chemin qui nous attend et à surmonter les défis de notre époque.
C’est cet esprit qui nous anime chaque jour, dans tous les domaines de la vie nationale, afin de faire de l’Angola un pays capable d’offrir à chacun la possibilité de réaliser ses rêves.
Quelles que soient l’ampleur des difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, faisons-en le pilier du changement et cultivons les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité et d’amour pour notre pays, car notre histoire nous a montré que ce n’est qu’ensemb1e que nous surmonterons les défis du présent et de l’avenir.
À l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de l’indépendance nationale, le plus bel hommage que nous puissions rendre au pays est de promouvoir une plus grande unité entre nous, en mettant de côté nos différences pour renforcer la nation.
Propos recueillis par Yves Laurent Goma
